Déclaration de performance extra‑financière (DPEF) : obligations et contenus
Tout savoir sur la DPEF

L’essentiel à retenir
- La DPEF a été remplacée par le reporting de durabilité issu de la CSRD.
- La CSRD introduit un cadre européen harmonisé, fondé sur les normes ESRS, la double matérialité et un audit renforcé.
- Le périmètre de la CSRD a été réajusté par le paquet Omnibus : moins d’entreprises que prévu sont directement concernées, mais l’impact reste large.
- Toutes les entreprises auparavant soumises à la DPEF ne sont pas nécessairement concernées par la CSRD aujourd’hui.
- Les bonnes pratiques issues de la DPEF restent un socle utile pour structurer un reporting extra-financier ou se préparer à la CSRD.
La Déclaration de performance extra-financière (DPEF) a constitué l’outil principal du reporting ESG obligatoire en France pendant plusieurs années. Elle obligeait certaines entreprises à publier des informations relatives à leur politique RSE et à leurs impacts sociaux, environnementaux et sociétaux. Avec l’arrivée de la CSRD et des nouvelles normes européennes de durabilité, la DPEF n'existe plus, mais elle reste une étape clé pour comprendre l’évolution du rapport extra-financier en Europe. Tour d'horizon avec par les experts du logiciel CSRD Toovalu.
DPEF : définition et origine

Qu'est ce que la DPEF ?
La DPEF était une déclaration extra-financière intégrée au rapport de gestion des entreprises, obligatoire jusqu'en 2025 (déclaration sur l'exercice 2024). Mise en place en 2017 pour transposer en droit français la directive européenne NFRD (Non-Financial Reporting Directive), elle visait à renforcer la transparence des entreprises sur leurs pratiques sociales et environnementales.
En pratique, la DPEF était un document réglementaire publié chaque année par les entreprises concernées. Souvent piloté grâce à un logiciel de reporting extra-financier, le rapport DPEF exposait les principaux risques liés à l’activité d'une entreprise ou d'un groupe, les politiques mises en œuvre pour y répondre et les résultats obtenus. La DPEF n’etait pas un simple exercice de communication : elle était vérifiée par un organisme tiers indépendant (OTI) qui attestait de la sincérité et de la qualité des informations publiées.
Contenu obligatoire de la DPEF
La réglementation définissait un contenu DPEF précis. Le rapport devait présenter :
- Le modèle d'affaire de la société
- Les risques majeurs en matière sociale, environnementale, sociétale et de respect des droits humains, ainsi que les risques de corruption et d'évasion fiscale pour les sociétés et groupe côtés
- Les politiques mises en œuvre par l’entreprise pour gérer ces risques
- Les résultats de ces politiques, assortis d’indicateurs de performance pertinents
Environnement
En matière environnementale, cela incluait notamment d'appréhender les risques suivants :
- Les émissions de gaz à effet de serre,
- L’utilisation des ressources
- La gestion des déchets
- La préservation de la biodiversité.
Société
Sur le plan social, la DPEF abordait l’emploi, la formation, la santé et la sécurité au travail, ainsi que le dialogue social. Les thématiques relatives aux droits humains et à la lutte contre la corruption étaient également obligatoires pour certaines sociétés.
Réglementaire
Si le contenu réglementaire était balisé, des recommandations complémentaires existaient. L’Autorité des marchés financiers (AMF), par exemple, incitait les entreprises à fournir des indicateurs quantitatifs, comparables dans le temps, et à expliquer les liens entre leur performance financière et leur performance extra-financière. Une publication RSE claire et documentée permettait d’améliorer la confiance des investisseurs et d’anticiper les obligations futures.
Les entreprises qui étaient concernées par la DPEF
Les critères pour être soumis à la DPEF
Quatre éléments permettaient de savoir si l'entreprise était concernée :
1. Sa forme juridique
2. Ses effectifs moyen
3. Son total de bilan
4. Son chiffre d’affaires net
Qui était concerné par l’obligation de DPEF ?
L’obligation de publier une DPEF concernait uniquement certaines catégories d’entreprises :
- Les sociétés cotées sur un marché réglementé, dès lors qu’elles dépassaient 500 salariés et 20 M€ de total de bilan ou 40 M€ de chiffre d’affaires.
- Les sociétés non cotées qui dépassaient 2 des 3 seuils suivants : 500 salariés, 100 M d’euros de bilan (total), 100 M d’euros de chiffre d'affaires.
- Les filiales de groupes étrangers qui remplissaient ces critères en France
Pour les autres entreprises, la DPEF n’était pas obligatoire mais pouvait être rédigée volontairement afin de répondre aux attentes des clients, des investisseurs ou des parties prenantes.

Le remplacement de la DPEF par la CSRD
En 2026, la DPEF est devenu obsolète, avec le Green Deal et la mise en place progressive des obligations issues de la CSRD, entrée en application en janvier 2024. Cette directive a remplacé la NFRD au niveau européen. Et donc, en France, la DPEF.
La CSRD introduit un cadre plus ambitieux. Elle impose à de grandes entreprises de publier un reporting ESG obligatoire, cette fois selon les normes européennes ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Contrairement à la DPEF, qui laissait une certaine liberté dans la présentation de sa déclaration, la CSRD impose un format standardisé et des indicateurs détaillés, comparables à l’échelle européenne.
La DPEF n'est plus effective, mais elle aura servi de socle pour préparer les entreprises à ce changement majeur.
Normes détaillées, volumes de données plus massifs et audit obligatoire : l'écart est important entre ces 2 obligations de reporting extra financiers. Sans méthode et préparation préalable, le passage de la DPEF à la CSRD peut être source de tensions et de difficultés pour l'entreprise. Dans notre article dédié, découvrez comment basculer d’une DPEF assez souple à un cadre CSRD plus exigeant.
CSRD vs DPEF : quelles différences pour les entreprises ?
DPEF vs CSRD : l’évolution du périmètre des entreprises concernées
La DPEF a été remplacée par le rapport de durabilité imposé par la directive CSRD : elle ne constitue plus un dispositif distinct depuis l’exercice 2025 et sert désormais de point de départ au reporting harmonisé européen.
La directive CSRD est applicable aux exercices ouverts à compter de 2024, avec publication des premiers rapports en 2025 pour les entreprises de la première vague selon les règles européennes.
Parallèlement, dans le cadre du paquet Omnibus de simplification adopté au niveau de l'UE, plusieurs éléments du scope et du calendrier CSRD ont été ajustés.
Seuils d'application et calendrier
Les seuils d’application de la CSRD sont relevés pour concentrer l’obligation sur les entreprises plus grandes (plus de 1 000 salariés et réalisant plus de 450M d’euros de CA) à partir de 2028 (sur l’exercice 2027).
Pour connaître la situation exacte de votre entreprise, téléchargez le calendrier CSRD post omnibus
Simplification des obligations de reporting
Suite à l'omnibus, les obligations de reporting relatives aux normes ESRS ont été allégées et simplifiées, pour réduire les charges administratives
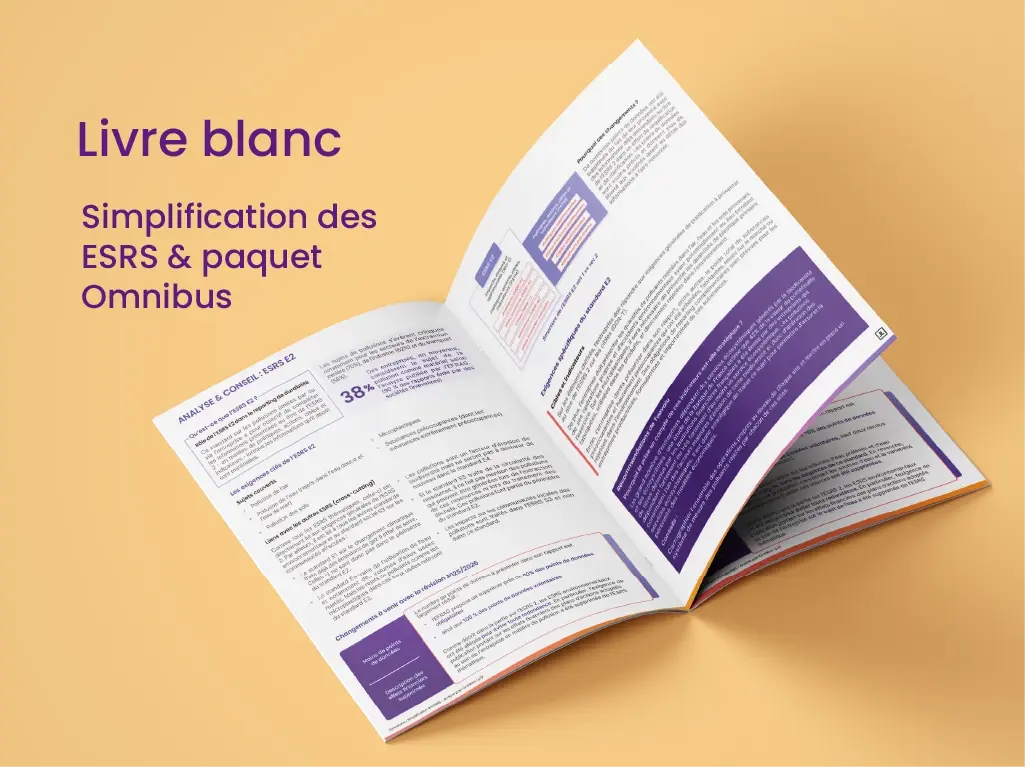
DPEF et CSRD : plus ou moins d’entreprises concernées ?
Avant l’Omnibus, la CSRD marquait une extension massive du périmètre par rapport à la DPEF. Alors que la NFDR ne concernait qu'environ 11 000 grandes entreprises en Europe (dont 5000 en France), la CSRD devait initialement s’appliquer à près de 50 000 entreprises, en intégrant de nombreuses entreprises non cotées, des PME cotées et des filiales de groupes internationaux. Dans cette première version, toutes les entreprises auparavant soumises à la DPEF entraient automatiquement dans le champ de la CSRD, avec des exigences renforcées (normes ESRS, double matérialité, audit, format numérique).
Avec le paquet Omnibus, la logique évolue nettement. L’objectif affiché est de réduire le nombre d’entreprises soumises au reporting de durabilité et de concentrer l’obligation sur les structures les plus grandes et les plus à risque. Les seuils sont relevés (1 000 salariés et 450M d'euros de CA) à partir de 2028. De plus, certaines catégories de sociétés initialement prévues sont exclues. Résultat : le périmètre CSRD devient plus restreint que prévu.
Conséquence importante : toutes les entreprises anciennement soumises à la DPEF ne sont plus nécessairement concernées par la CSRD aujourd’hui. Les entreprises de taille intermédiaire qui relevaient de la DPEF mais qui ne franchissent pas les nouveaux seuils définis après l’Omnibus sortent du champ obligatoire. Pour autant, beaucoup d’entre elles restent indirectement concernées, notamment via les exigences de leurs clients, investisseurs ou donneurs d’ordre soumis à la CSRD.
Ce qui change concrètement pour les entreprises avec la fin de la DPEF
Le passage de la DPEF à la CSRD ne constitue pas une simple évolution de format : il modifie en profondeur la manière dont les entreprises doivent aborder leur reporting extra-financier.
Ce cadre devient plus complet, précis et standardisé, et transforme profondément les pratiques. Les entreprises doivent désormais :
- analyser leurs impacts, risques et opportunités (IRO) selon une analyse de double matérialité
- structurer leurs données selon des standards européens (les ESRS)
- documenter l’ensemble des méthodes utilisées
- préparer un audit annuel du rapport de durabilité, intégré au rapport de gestion
CSRD vs DPEF : les différences majeures
Origine du cadre
Transposition de la directive européenne NFRD, La DPEF reposait également sur un premier dispositif français de reporting environnemental et social, instauré par la loi NRE. Le reporting de durabilité s'appuie quant à lui sur une directive européenne plus détaillée, construite autour des normes ESRS et pensée pour uniformiser le reporting au niveau européen.
Format attendu
La DPEF laissait une certaine liberté d’écriture : les entreprises organisaient leur contenu comme elles le souhaitaient, avec un niveau d’indicateurs très variable. La CSRD suit une logique totalement différente : la structure découle directement des normes ESRS, avec des exigences précises sur la manière de présenter les informations et sur le format numérique à utiliser.
Indicateurs et niveau de détail
Avec la DPEF, les indicateurs choisis variaient selon la maturité RSE de l’entreprise. La CSRD impose des indicateurs précis, couvrant l’ensemble des thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec une granularité nettement supérieure et une attente de traçabilité sur toutes les données publiées.
Matérialité et priorisation des sujets
La DPEF autorisait une sélection libre des enjeux importants. La CSRD impose une analyse de double matérialité : d’un côté les impacts environnementaux et sociaux de l'entreprise, de l’autre les conséquences financières pour l'entreprise, liées à ces mêmes enjeux. Cette lecture croisée transforme souvent la hiérarchisation interne et demande une méthodologie rigoureuse.
Documentation et preuves
La DPEF offrait une marge d’interprétation importante sur la manière de justifier les informations. La CSRD exige une documentation complète : méthodes de calcul, sources, périmètres, hypothèses, limites et traçabilité opérationnelle. Le rapport doit comporter suffisamment d’éléments pour être auditable.
Audit
Les rapports DPEF devaient faire l'objet d’une vérification par un OTI (organisme tiers indépendant). Celui-ci statuait sur la présence et de la cohérence des informations contenues dans le reporting. La CSRD exige elle aussi une vérification par un OTI, et cet audit devient même plus exigeant.
Organisation interne
La DPEF était gérée principalement par les équipes RSE ou communication. La CSRD requiert une mobilisation plus large : finance, juridique, achats, RH, métiers, COMEX. Le reporting devient un sujet stratégique qui engage l’ensemble de la gouvernance.
Conclusion
La DPEF a eu un rôle important dans l’évolution du reporting ESG obligatoire en France. Document de transition, elle aura permis de familiariser les grandes entreprises avec la publication d’informations extra-financières. Pour les entreprises concernées, l'enjeu est aujourd'hui de réussir leur transition de la DPEF vers le reporting CSRD de manière efficace. Dans cet article dédié, retrouvez les conseils de nos experts CSRD sur le sujet.
Pionnier des logiciels de reporting extra-financier et du consulting RSE, CSRD et ESG depuis 2012, Toovalu accompagne plus de 500 entreprises de toutes tailles pour améliorer leur performance extra-financière et réussir leurs audits de conformité.
Questions fréquentes DPEF CSRD
La DPEF est-elle encore obligatoire en 2026 ?
Non. La DPEF n’est plus un cadre réglementaire en vigueur. Elle a été remplacée par le rapport de durabilité issu de la CSRD. Les entreprises qui entrent dans le périmètre de la CSRD publient désormais un reporting de durabilité conforme aux normes ESRS, et non plus une DPEF. Les entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD n’ont aucune obligation légale de publier une DPEF, même si certaines continuent à s’en inspirer à titre volontaire ou contractuel.
Quels étaient les thèmes obligatoires dans une DPEF ?
La DPEF portait sur les principaux risques et enjeux extra-financiers liés à l’activité de l’entreprise, notamment :
- les enjeux environnementaux,
- les enjeux sociaux et sociétaux,
- le respect des droits humains,
- la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale.
Pour chaque thème, l’entreprise devait décrire les politiques mises en œuvre, les actions associées et, lorsque pertinent, les résultats obtenus à l’aide d’indicateurs.
Ces thématiques constituent aujourd’hui un socle repris et approfondi par la CSRD.
Fallait-il un auditeur pour valider la DPEF ?
Oui, la DPEF faisait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI), chargé d’attester de la présence et de la cohérence des informations publiées. Avec la CSRD, ce contrôle externe devient plus central et plus exigeant.
Les PME étaient-elles concernées par la DPEF ?
Les PME n’étaient pas concernées par la DPEF. La CSRD avait initialement prévu un élargissement du périmètre de reporting de durabilité à certaines PME cotées, mais le paquet Omnibus a finalement réduit ce périmètre. En pratique, même lorsqu’elles ne sont pas soumises directement, de nombreuses PME sont indirectement concernées, notamment via les demandes d’information de leurs clients, partenaires ou financeurs soumis à la CSRD.
La DPEF a-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ?
En tant qu’obligation légale, non.
En revanche, les bonnes pratiques issues de la DPEF (structuration des risques, indicateurs, gouvernance, cohérence stratégique) restent pleinement pertinentes et constituent souvent un point d’entrée utile vers la CSRD ou vers d’autres démarches de reporting extra-financier.




