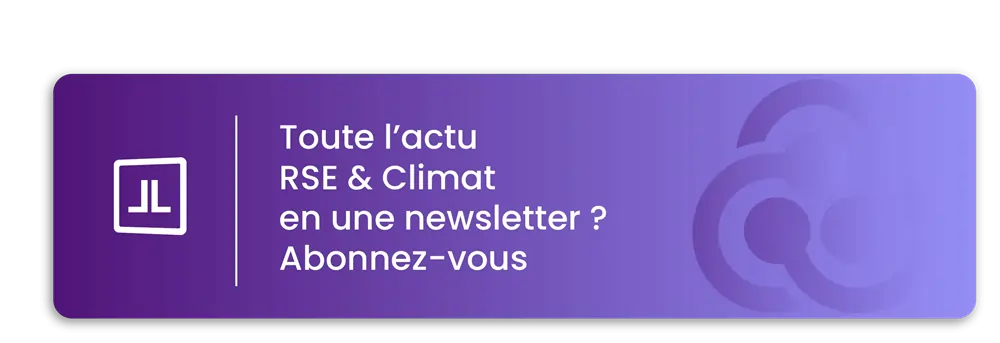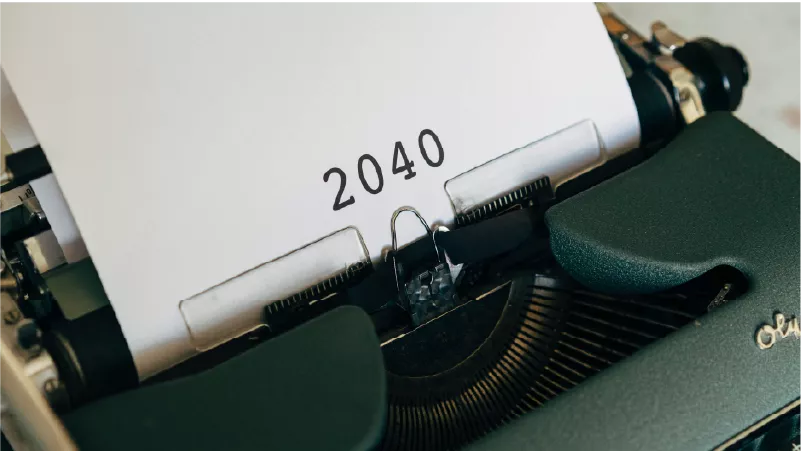Quel impact pourrait avoir Trump, l’anti-climat, sur la législation européenne ?
Décryptage par les journalistes du média indépendant Les Surligneurs

Coupure massive de financements, licenciements, censures… Outre-Atlantique, l’administration de Donald Trump s’attaque violemment aux institutions dédiées à la protection de l’environnement, aux réglementations vertes, ainsi qu’aux universitaires de la science du climat. Quelques jours après son retour à la Maison Blanche, le Président américain avait d’ailleurs décidé de sortir les États-Unis, la première économie du monde, de l’Accord de Paris. Une bien sombre nouvelle pour la planète à n’en pas douter. Mais quelle incidence aura ce brutal virage sur les législations vertes de l’Union européenne (UE) ?
L’hypothèse plus optimiste serait de voir en ce retrait américain une opportunité pour l’Europe de pousser ses propres normes à l’échelle mondiale (via le fameux « effet Bruxelles ») et, plus généralement, de se positionner en leader international de la lutte contre le changement climatique.
Ainsi, en matière de reporting ESG, domaine que Trump et ses équipes exècrent en particulier, la SEC américaine (l'organisme fédéral de réglementation des marchés financiers) est en train de revenir sur ses propres règles, qui devaient imposer aux entreprises cotées de publier des données sur les risques liés au climat.
Reste que l’Europe, précurseure en la matière – avec notamment sa directive sur le reporting de durabilité (CSRD) – est aussi en train de reculer, bien que de manière moins radicale : la Commission européenne a en effet proposé, fin février, de détricoter plusieurs éléments clés de la CSRD, et de la directive européenne sur le devoir de vigilance (CS3D).
Premières réactions américaines à la législation européenne
Le « choc de simplification » proposé par l’exécutif européen va toutefois faire l’objet de négociations à Bruxelles … Et, vu le champ d’application large des législations en question, il n’est pas exclu que l’attitude de Washington ait de l’influence sur les pourparlers. En effet, la CSRD, et plus encore la CS3D en application de son article 2, s’appliquent à certaines entreprises étrangères, américaines en premier lieu.
Ce qui n’a pas échappé à la galaxie Trump. Aux États-Unis, un sénateur républicain a ainsi proposé une loi qui interdirait aux entreprises américaines de se conformer à ce type de législations étrangères. L’objectif du projet du dénommé Bill Hagerty : protéger les firmes états-uniennes des « régulations extraterritoriales néfastes », le devoir de vigilance européen étant explicitement visé.
Au vu de la logique dite « transactionnelle » de l’administration américaine, on pourrait très bien imaginer ces directives vertes de l’UE, ainsi que les régulations européennes ciblant les géants du numérique, être liées à des tractations plus larges autour des droits de douane de Donald Trump.
« Nous pourrions être en train d’affaiblir notre propre position dans le commerce international en assouplissant les réglementations de l'UE à portée extraterritoriale, alors que celles-ci pourraient servir de levier crucial pour responsabiliser les États-Unis, et surtout la Chine, et peser sur de futures négociations commerciales », estime ainsi l'eurodéputé bulgare Radan Kanev (PPE, droite).
L’Europe pourrait-elle voir revenir des investissements partis aux États-Unis ?
Vu sous un autre angle, les mesures protectionnistes massives annoncées par Donald Trump ce 2 avril et les craintes qu’elles suscitent pour l’économie européenne, renforcent au sein des institutions de l’UE la conviction que la priorité doit être donnée à la compétitivité. Autrement dit : l’heure n’est décidément plus à imposer aux entreprises de nouvelles régulations environnementales.
La Commission européenne veut plutôt faciliter la vie des industries, vertes y compris : l’exécutif de l’UE multiplie les initiatives pour essayer de soutenir sur le Vieux continent les filières stratégiques de l’acier, de l’automobile, des batteries, des minerais, etc.
Du point de vue des industries vertes, les répercussions de la politique de Donald Trump sont aussi susceptibles de se faire sentir en Europe. Le président américain mettra-t-il un terme à l'« Inflation Reduction Act », ce plan de 380 milliards de dollars d’investissement dans les technologies vertes hérité de l’administration Biden ?
Serait-ce une mauvaise nouvelle pour le climat… et une chance pour l’attractivité européenne ? L’« IRA », dont les crédits d’impôts et les subventions – en faveur notamment des filières des renouvelables et des voitures électriques – sont en partie réservés aux produits « made in USA », a été jugé discriminatoire de ce côté-ci de l’Atlantique depuis son lancement en 2022. De fait, le plan a massivement aspiré des investissements qui auraient pu avoir lieu en Europe.
Reste que les observateurs ne voient pas Donald Trump tout stopper : les investissements en question bénéficient de manière disproportionnée à des industries basées dans des États républicains. Un scénario plus vraisemblable serait que la Maison Blanche diminue les crédits alloués et les réoriente en partie vers les énergies fossiles américaines, que Donald Trump s’efforce plus globalement de booster, en dépit de la solide compétitivité des renouvelables outre-Atlantique.
« Sans le leadership européen, la prochaine COP sera une catastrophe »
En tout état de cause, « il y aura plus de réticence à investir dans certains de ces secteurs axés sur la transition énergétique et le climat, car l'environnement politique est clairement moins attrayant pour ces investissements aujourd'hui (...) », analyse Jackson Ewing, expert du Nicholas Institute for Energy, Environment & Sustainability, cité dans un article du Time. La Chine pourrait en profiter pour renforcer son leadership technologique dans nombre de ces domaines (voitures électriques, terres rares et autres minerais, batteries…). L’UE tirera-t-elle aussi son épingle du jeu ?
Enfin, sur le plan de la diplomatie climatique, l’Union a dorénavant un rôle des plus déterminants à jouer. « Sans le leadership européen, la prochaine COP sera une catastrophe, résume Pierre Leturcq, chargé de programme à l’Institute for European Environmental Policy. Mais la condition sine qua non de ce leadership est de parvenir à travailler avec les pays émergents, à commencer par l’Inde et le Brésil ».
Pour cela, l'UE devra en particulier trouver un terrain d’entente avec ces pays au sujet de son controversé mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, cette législation qui doit taxer certains produits importés en Europe en fonction de leur empreinte carbone à partir de début 2026.
Certains bruits suggèrent d’ailleurs que l’administration Trump pourrait aussi créer à l’avenir sa propre taxe carbone aux frontières. Mais la motivation serait là bien plus protectionniste que climatique : contrairement à l’Europe, les États-Unis ne disposent pas, au niveau fédéral, d’un dispositif de tarification du carbone sur les produits nationaux.
Rédacteur : Clément Solal, journaliste
Relecteur : Vincent Couronne, docteur en droit européen & Sophie Bridier, rédactrice en cheffe ESG chez Lefebvre Dalloz