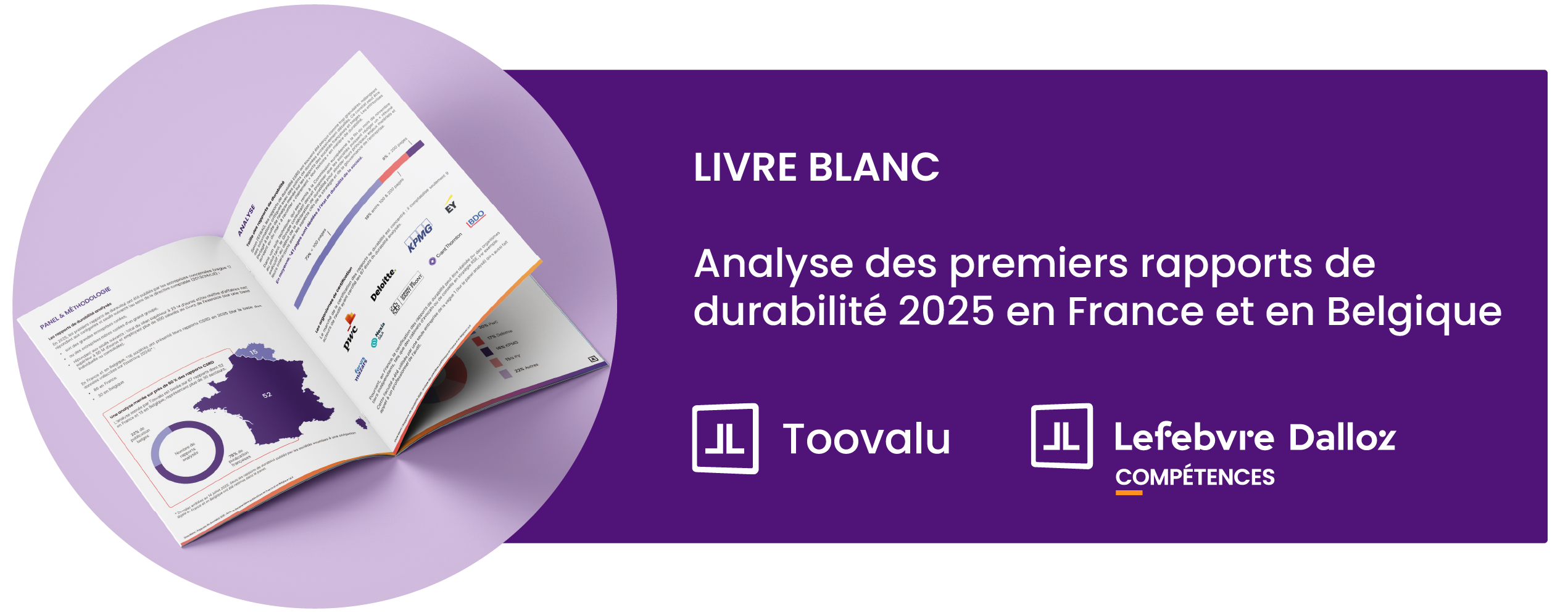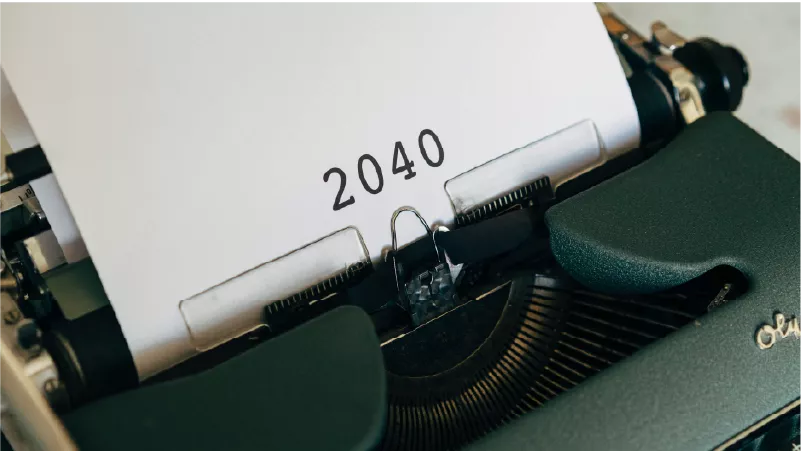Pourquoi les défenseurs de la CSRD et du devoir de vigilance restent impuissants face aux manœuvres des conservateurs européens
Le Parlement européen rebat les cartes du Green Deal

Un vote décisif du Parlement européen sur les directives vertes
Après les vingt-sept États membres, les eurodéputés ont pris position lundi en faveur d’un rabotage radical des directives sur le reporting de durabilité, ou « CSRD », et sur le devoir de vigilance. Les groupes social-démocrate et centriste n’ont eu d’autre choix que de se coucher face aux exigences de la droite de l’UE. Et ce scénario a toutes les chances de se reproduire à l’avenir, sur d’autres réformes. Explications.
Les défenseurs de la politique ESG de l’UE sont restés impuissants, ce 13 octobre, face à la dure réalité de l’arithmétique parlementaire. La commission des Affaires juridiques du Parlement européen a voté sa position sur la législation dite « Omnibus », proposée le 26 février dernier par la Commission européenne, et visant à simplifier plusieurs réglementations emblématiques du Green Deal.
Deux directives emblématiques dans le viseur
Parmi les textes ciblés : la directive sur le reporting de durabilité (la fameuse « CSRD »), qui impose chaque année à certaines entreprises de déclarer des informations ESG (émissions de CO₂, gestion des déchets, utilisation de l’eau, égalité salariale…), et la directive sur le devoir de vigilance.
Une « simplification » du Green Deal qui vide les directives de leur substance
À la suite des États membres, qui s’étaient positionnés sur l’Omnibus en juin dernier, les eurodéputés ont programmé un rabotage drastique de ces lois, à commencer par leur champ d’application. Quand la Commission avait prévu d’épargner « environ 80 % » des 42 500 entreprises qui devaient initialement être concernées par la CSRD, les eurodéputés, comme les Vingt-Sept, ont souhaité aller encore plus loin, avec un nouveau double seuil fixé à 1 000 salariés et à 450 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
Un compromis entre trois groupes politiques
Le texte voté lundi par le Parlement de Strasbourg est le fruit d’un compromis entre trois groupes politiques : les conservateurs du PPE, les sociaux-démocrates du S&D, et les centristes de Renew. Comment expliquer que ces deux dernières formations dont beaucoup de membres, notamment au centre-gauche, soutiennent lesdites législations vertes, aient pourtant souscrit à un tel détricotage ? C’est que ces députés n’avaient pas tellement le choix…
Le rapport de force politique tourne à l’avantage du PPE
Depuis les élections européennes de juin 2024, le PPE, la première force de l’hémicycle qui, pour le coup, honnit la CSRD comme le devoir de vigilance, peut théoriquement former une majorité aux côtés des différents groupes d’extrême droite. Si les conservateurs s’allient traditionnellement avec le centre et la gauche, le PPE a néanmoins fait pleinement usage du pouvoir de négociation que cette nouvelle situation lui confère. Jusqu’à la dernière minute, le groupe a fait planer la menace de pactiser avec la droite la plus dure, dans le cas où Renew et le S&D ne cédaient pas à toutes ses demandes.
Une stratégie assumée de la droite européenne
Cette stratégie, qui sera sans aucun doute réitérée à l’avenir – probablement sur la nouvelle « loi climat » devant fixer les objectifs de réduction des émissions de l’UE à l’horizon 2040 –, est d’ailleurs assumée.
« Il est très clair (...) que les majorités ont changé au Parlement, et tous les groupes politiques doivent s’adapter à cette nouvelle réalité », a ainsi expliqué Jörgen Warborn, principal négociateur du PPE sur le dossier. Si les centristes et les sociaux-démocrates ne se couchent pas, « alors il est aussi possible de construire une autre majorité », a martelé ce conservateur suédois cité par Politico.
Le sort du paquet Omnibus : un recul assumé des ambitions européennes
Le chemin législatif de l’Omnibus n’est pas encore terminé. Le sort de la CSRD et du devoir de vigilance n’en semble pas moins déjà jeté depuis le vote de lundi. Une fois que les parlementaires auront entériné leur position en séance plénière, les États membres et le Parlement devront s’entendre sur la version finale de la réforme, dans les négociations en « trilogues » qui devraient commencer d’ici début novembre. Les points d’incertitudes sont peu nombreux, tant les copies sont déjà proches. Ainsi, les deux institutions ont confirmé la réduction massive, de 60 à 70 %, des points de données que les entreprises auront à collecter au titre de la CSRD.
Des seuils relevés et un champ d’application restreint pour le devoir de vigilance
Du côté de la directive sur le devoir de vigilance, censée imposer à compter de 2027 aux grands groupes de traquer et de combattre les atteintes aux droits humains ou à l’environnement éventuellement causées par leur activité — ou par celles de leurs partenaires —, le rabotage programmé est encore plus impressionnant. Pour ce texte controversé, et chouchou des ONG, les nouveaux seuils devraient monter à 5 000 employés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Suppression du mécanisme de responsabilité civile
Les co-législateurs s’accordent en outre pour supprimer le mécanisme européen de responsabilité civile des entreprises, qui constituait le cœur de la directive. L’idée était que des entreprises puissent être tenues civilement responsables, à l’échelle de l’Union, des dommages causés, sous certaines conditions, en cas de manquement à leurs obligations de vigilance.
Des plans de transition désormais non contraignants
Un autre des affaiblissements majeurs touche aux plans de transition climatique exigés par la directive (l'article 22, lutte contre le changement climatique). Les entreprises ciblées auront bien à concevoir de telles stratégies pour expliciter comment elles entendent « contribuer » aux objectifs climatiques de l’UE, et en particulier à ceux de l’accord de Paris. Les entreprises seront-elles pour autant tenues de mettre en œuvre ces plans, comme initialement prévu ? Il semble que non, les eurodéputés, comme les vingt-sept États membres, ayant finalement opté pour un langage juridiquement peu contraignant.
Les pro-Green Deal entre résignation et dépit
Chez les soutiens du Green Deal, on observe deux types de réactions. Il y a d’une part ceux qui accusent le coup à l’instar des ONG environnementales, et du groupe des Verts, qui n’a pas voté le texte de compromis au Parlement.
Les critiques des Verts et des ONG
« La responsabilité civile et l’obligation de mettre en œuvre des plans de transition climatique constituent la colonne vertébrale d’une législation crédible en matière de durabilité. En supprimant ces éléments, cet accord vide nos lois de sens », a ainsi lancé l’eurodéputée verte danoise Kira Peter-Hansen.
Le même dépit a été exprimé par la Néerlandaise Lara Wolters (S&D) qui, connue pour avoir été la rapporteure du Parlement sur le devoir de vigilance entre 2022 et 2024, a cette fois démissionné de son rôle de « rapporteure fictive » du texte Omnibus, dans la foulée du vote de lundi.
Les centristes défendent une vision pragmatique
Et il y a d’autre part ceux qui s’efforcent de voir le verre à moitié plein, comme l’eurodéputé français centriste Pascal Canfin. « Bien que cet accord ne soit pas idéal sur tous les plans, il permet au Parlement d’entamer les trilogues (…) pour parvenir à une simplification efficace et utile aux entreprises. Ces textes faciliteront la réalisation de nos objectifs environnementaux et sociaux et nous permettront de continuer à bâtir des règles européennes robustes », a estimé l’ancien dirigeant d’EELV, faisant entre autres valoir « des coûts d’audit réduits » pour les entreprises dans le cadre de la CSRD.