
Sophie Bridier
31.10.2025
IA
Comment assurer la sobriété de l'IA en interne ?

Si au sein d’une entreprise se pose la question de la mise en place d’un nouvel outil ou service d’IA, comment assurer de sa sobriété ? Voici quelques conseils méthodologiques par les chercheurs de Toovalu, logiciel RSE.
« La première étape consiste à bien réfléchir au service qui va être rendu par l’IA. Il n’est pas toujours nécessaire d’y recourir. Si un train fait Paris-Toulouse et que l’on ne souhaite pas se rendre à Toulouse, ce n’est pas la peine de monter dedans. Ce n’est pas le bon train même si tout le monde, sur le quai, le prend. Si au contraire, le développement d’une IA permet de réaliser une tâche répétitive, sans aucune valeur ajoutée au sens économique ou social, et qu’elle facilite la vie de ses utilisateurs, à la fois pour leur bien-être ou pour un rendement financier ou social, alors il faut se lancer », précise Florian Pothin, data scientist chez Toovalu et doctorant. Se questionner sur l’usage de l’outil, en cours de développement, est un prérequis.
Attention aussi aux effets rebonds : « On a tendance à croire qu’avec l’IA on va être plus efficace ou remplacer un usage désuet. Mais souvent les usages s’additionnent. On ne remplace pas toujours des solutions existantes, parfois de nouvelles sont créées avec de l’IA tout en maintenant les plus anciennes », prévient Thomas Gilormini, chef de projet climat chez Toovalu et chercheur en décarbonation. Or, plus il y a de solutions sur le marché, plus il y a d’impact environnemental.
Après avoir réfléchi à l’usage et aux potentiels effets rebonds, vient la mesure concrète de l’impact environnemental du service à déployer. Avant de lancer une IA, il convient de la dimensionner dès le début, c’est-à-dire de la rendre adaptée à des usages précis. Pour mesurer son coût environnemental, « il existe plein d’outils (code carbon ou Ecolab), de méthodes et de services gratuits qui peuvent aider en la matière », mentionne Florian Pothin. Et attention, « il est plus simple de penser une IA responsable que de transformer une IA existante », prévient Florian Pothin.
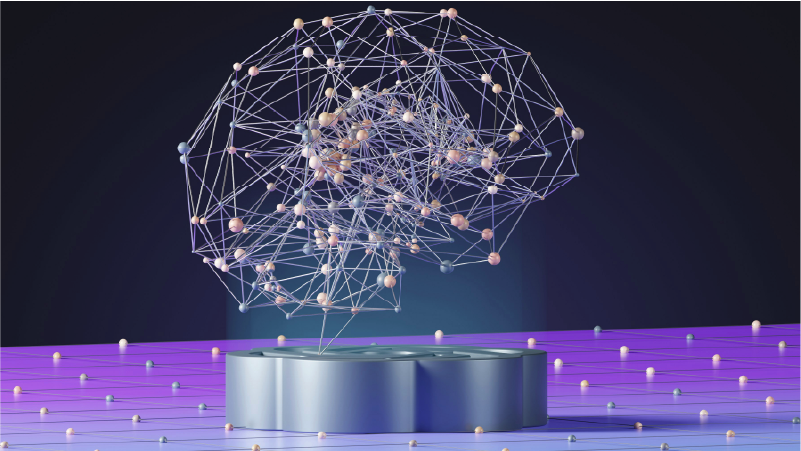
Autre possibilité, utiliser la méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) avec ses référentiels très pointus. Elle permet de mesurer l’impact environnemental de produits et de services en considérant toutes leurs étapes de « cycle de vie ». Dans le cas de l’IA, « il s’agit de mesurer son impact de la conception du modèle à son utilisation chez l’internaute », décrit Thomas Gilormini. Sans oublier « tout ce que cela implique, c’est-à-dire l’utilisation de matériel lié à chacune des différentes étapes », complète Florian Pothin. Sont donc pris en compte l’extraction des ressources nécessaires à la construction des data centers, leur fabrication, l’électricité utilisée pour les alimenter et les impacts liés aux terminaux des utilisateurs (smartphones, ordinateurs, etc.), sans oublier la fin de vie de l’ensemble de ces maillons de la chaîne. « Pour mener à bien son analyse, il est recommandé de retenir plusieurs critères tels que les émissions de gaz à effet de serre, l’énergie primaire, l’eau consommée ainsi que les ressources utilisées. Et pour réaliser une ACV complète, on ajoutera encore d’autres critères environnementaux », note Thomas Gilormini.
Pour obtenir des mesures fiables, quelles sources utiliser ? « Il n’y a pas encore de base de référence propre à l’impact des usages des IA mais il convient de s’appuyer sur des bases de références classiques ou scientifiques. L’outil Ecologits, par exemple, estime l’impact d’une requête OpenAI », indique Thomas Gilormini.
Enfin, selon quelle périodicité revoir son analyse ? « On peut adopter le même réflexe qu’en matière de bilan carbone. Il faut le faire régulièrement, au moins tous les 3 ans, les outils numériques évoluant très vite. Surtout si on veut suivre les actions mises en place pour réduire les impacts recensés. Dans le cas où des changements importants sont menés sur l’architecture de l’IA (lorsqu’on double la capacité de stockage pour augmenter la puissance du modèle, par exemple) », il faut également refaire l’exercice, conseille Thomas Gilormini. Attention aussi aux facteurs exogènes : « lorsque l’on fait appel aux géants de la tech, au sein de nos propres modèles, il faut garder en tête qu’ils évoluent rapidement. Si on opte pour GPT 5.0 au lieu de GPT 4.0, cela aura des conséquences » sur l’impact environnemental de sa solution, ajoute Florian Pothin. Et il faudra, une nouvelle fois, relancer l’analyse…