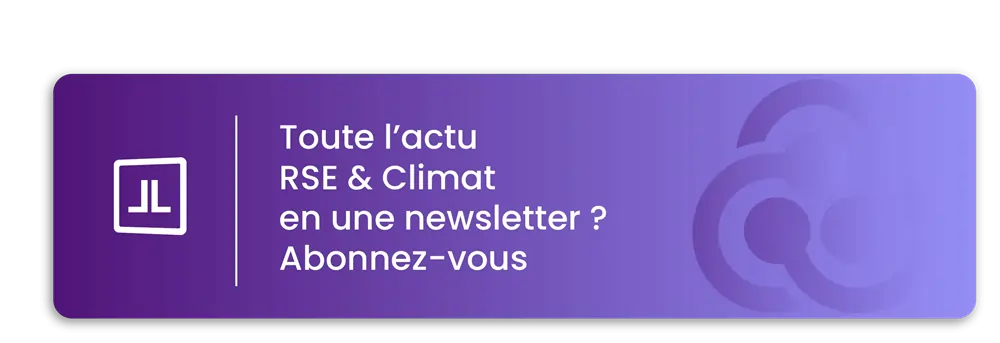Les Surligneurs
31.10.2025
RSE
Décryptage par les journalistes du média indépendant Les Surligneurs

Nombreuses et très actives à Bruxelles, les ONG pro-environnement font l’objet de lourdes mises en cause de la part de la droite de l’UE qui dénonce notamment l’existence d’un système de « lobbying fantôme » : des ONG auraient suivi les « instructions » de la Commission européenne en échange de subventions. Si les preuves font défaut, celles qui ont contribué à façonner le Green Deal européen pourraient à l’avenir voir leurs financements coupés, à l’heure où l’UE a enclenché la marche arrière sur le plan écologique. Décryptage.
Y a-t-il quelque chose de louche quant aux aides publiques versées par l’UE aux ONG vertes ? C’est ce qu’affirment à cor et à cri de nombreux élus de l’hémisphère droit du Parlement européen. Depuis fin 2024, le Parti populaire européen (PPE, droite), le premier groupe de l'hémicycle, dénonce, en particulier, l’existence d’un prétendu système de « lobbying fantôme » liant ces organisations à la Commission européenne. Ces dernières années, des ONG auraient reçu des subventions de l’exécutif européen en échange de leur engagement à suivre ses « instructions » : c’est-à-dire à faire pression sur des parlementaires et les États membres en faveur des projets de réforme du Pacte vert européen.
De fait, nombreuses et très actives à Bruxelles, lesdites ONG, comme le Bureau européen de l'environnement, les Amis de la Terre, ou la fédération Transport et Environnement (T&E) ont grandement contribué à faire advenir le fameux « Green Deal » lors du précédent mandat de la Commission européenne (2019-2024).
À coups d’études scientifiques, de lettres ouvertes, de rendez-vous avec les législateurs et autres évènements, les ONG ont participé à modeler les multiples législations vouées à faire évoluer les secteurs des transports, de l’énergie, des industries lourdes, de la finance, ou encore du commerce international vers l’objectif de neutralité carbone en 2050. Pour autant, les accusations du PPE, initiées par la chrétienne-démocrate allemande Monika Hohlmeier et abondamment reprises à l’extrême droite, sont-elles étayées ?
Celles-ci ciblent spécifiquement les subventions versées aux ONG dans le cadre du programme du budget européen « LIFE » (Règlement du 29 avril 2021), doté de 5,4 milliards d’euros sur la période 2021-2027. « L’UE finance des ONG pour faire du lobbying. 5,5 milliards d’euros pour diffamer les agriculteurs et attaquer nos entreprises déjà asphyxiées », s’était par exemple insurgée l’eurodéputée Céline Imart (PPE; FR) en janvier 2025.
Sauf que, premièrement, les soupçons en question n’ont jamais concerné qu’une enveloppe annuelle de 15 millions d’euros, destinés aux dépenses de fonctionnement des ONG. Soit 0,2828% du budget du programme LIFE, et 50 fois moins que ce qu’avançait cette élue française. L’essentiel des fonds de LIFE sert en effet plutôt à financer des projets locaux (dans l’économie circulaire, l’adaptation au changement climatique, etc.) menés par divers acteurs (PME, agriculteurs, administrations, entités publiques, etc.).
Deuxièmement, et surtout, aucun élément tangible n’a à ce jour été produit pour appuyer ces mises en cause. Le média Politico Europe, qui a pu analyser en détail les contrats liant les ONG à la Commission, assurait dès février que « nulle part (...) la Commission ne donne des instructions directes de faire du lobbying pour son compte ».
Lorsqu’elles postulent, les ONG doivent certes fournir aux agences de l’UE (dont l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, ou CINEA) la liste des actions qu’elles entendent mettre en œuvre grâce à ces financements, y compris, le cas échéant, celles visant à influencer les décideurs (rendez-vous avec des élus, évènements, campagnes sur les réseaux sociaux, etc.). Mais ces programmes de travail, qui ne sont pas amendés par la Commission européenne, ne peuvent donc pas être qualifiés d’« instructions ».
« Ces accusations sont grotesques » estime Faustine Bas-Defossez, directrice Nature, Santé, et Environnement, au sein du Bureau européen de l'environnement (l’EBB, de son acronyme anglais), l’une des plus larges fédérations d’ONG environnementales en Europe. « Par exemple chez nous à l'EEB ce sont notre board et notre AG qui définissent nos actions et notre feuille de route, pas la Commission, nos membres ne l'accepteraient pas ».
Les réactions assez confuses de la Commission européenne ont cependant contribué à donner du crédit aux accusations. Dans un premier temps le commissaire au Budget, le conservateur polonais Piotr Serafin a semblé reconnaître l’existence de ce « lobbying fantôme », avant de démentir catégoriquement les faits, ce 14 avril, dans une lettre.
« Ces activités ne sont pas imposées par la Commission. La Commission ne prévoit pas les activités spécifiques à réaliser par les ONG dans leur programme de travail, ni ne leur donne d'instruction de soutenir quelconques positions spécifiques », est-il notamment écrit.
Fin de l’histoire ? Non, pas tout à fait. En parallèle, l’exécutif de l’UE a demandé aux ONG, via plusieurs courriers adressés ces derniers mois, d’éviter d’utiliser ces fonds à des fins de lobbying.
Il existe en fait une réelle zone d’ombre quant à la finalité de ces fonds. En effet, cette enveloppe de 15 millions d’euros (plafonnés à 700 000 euros annuels par ONG) doit théoriquement servir aux dépenses de fonctionnement des organisations (la location de bureau, l’achat d’ordinateurs, etc.). Mais elle est donc en partie utilisée pour financer des activités visant à influencer le jeu législatif.
Cette ambiguïté vient d’ailleurs d’être pointée par la Cour des comptes européenne dans un rapport sur le financement européen des ONG paru le 7 avril. Du côté des ONG, on dénonce une hypocrisie : l’intention derrière ces subsides a toujours été de contrebalancer quelque peu l’influence politique de lobbys d’entreprises privées aux moyens souvent infiniment plus élevés. La Commission ne pouvait donc pas ignorer que ces aides serviraient à tenter de peser sur les réformes de l’UE.
Le rapport de la Cour des comptes, qui ne se limite pas aux ONG vertes, soulève en outre plusieurs manques de transparence dont, en particulier : une absence de définition unifiée des ONG parmi les Vingt-Sept, ou encore, une difficulté à suivre les usages « indirects » des fonds versés par l’UE, au-delà du bénéficiaire direct. Si la publication a participé à relancer les attaques contre les ONG pro-environnement, ce document ne valide toutefois en rien les mises en causes initiales du PPE.
Reste que ces lourdes accusations, qui s’inscrivent dans un contexte législatif de recul des législations vertes du Green Deal, pourraient bien conduire l'UE à couper à l’avenir les aides en question, comme certains le réclament déjà au PPE et à l'extrême droite. « Cette campagne de dénigrement est en réalité une “revanche du PPE” qui n’a pas digéré certains points du pacte vert, en particulier la loi sur la restauration de la nature », juge Faustine Bas-Defossez. L’influence qu’avaient eu les ONG dans la conception initiale de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises, texte emblématique du Pacte Vert actuellement en train d’être détricoté, a aussi laissé un fort ressentiment à la droite du Parlement européen.
A Bruxelles, les ONG s’inquiètent dès lors de voir le programme LIFE sévèrement amputé dans le cadre du prochain budget européen (sur la période 2028-2034), alors que la droite et l’extrême droite forment désormais une majorité arithmétique au Parlement. L’enjeu est majeur : une suppression totale des aides pourrait « priver 30 ONG de jusqu’à 70% de leurs revenus annuels », indiquait le média britannique The Guardian en février dernier. L’Assemblée de l’UE devrait finaliser sa position initiale début mai concernant le futur budget. Puis de longues négociations auront lieu dans les instances de l’UE. Affaire à suivre, donc.
Rédaction : Clément Solal et Alexandre Gilles-Chomel, journalistes
Relecture : Vincent Couronne, docteur en droit européen