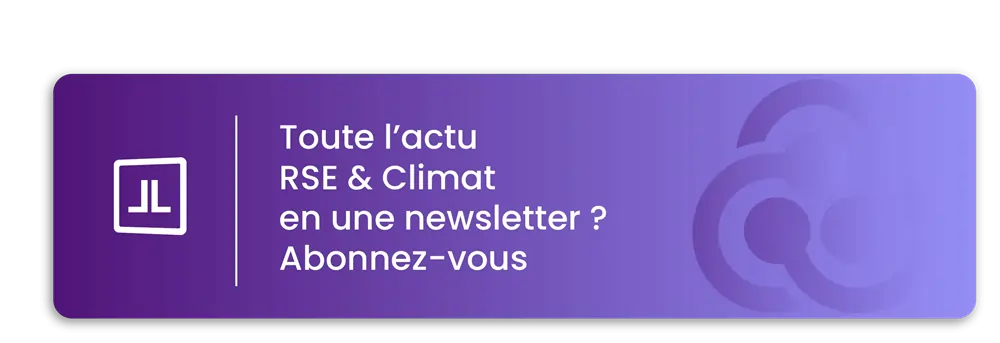« Allégations environnementales » : à Bruxelles, la lutte contre le greenwashing essuie des tirs de barrage
Décryptage par les journalistes du média indépendant Les Surligneurs

C’est un projet largement méconnu du grand public, qui aurait pourtant un impact important sur les consommateurs et les industries, et fait dès lors l’objet de tractations tendues au sein des instances de l’Union européenne. Le 24 avril à Bruxelles, s’est tenue l’une des ultimes réunions de négociations visant à finaliser la directive « sur les allégations environnementales explicites » (aussi appelée green claims directive). Un texte ambitieux destiné à lutter contre le greenwashing.
Biens « éco » ou « verts », « respectueux de l’environnement », objets « neutres en carbone », « à zéro émission nette », « produits avec des énergies renouvelables », ou encore comprenant « x% de contenu recyclé ». Une étude publiée en 2020 par la Commission européenne estimait que 53% de ce type d’allégations écologiques étaient « vagues, trompeuses ou non étayées ».
La grande nouveauté apportée par cette directive serait de contraindre les entreprises à faire vérifier le caractère scientifiquement étayé de ces allégations « ex ante ». Autrement dit, avant que les messages en question soient communiqués - sur l’emballage du produit, via le site internet de la société, ou encore dans une publicité, etc. Concrètement, des « organismes indépendants accrédités » dans chacun des États membres seraient chargés de contrôler qu’une étude suffisamment robuste appuie l’affirmation en question et, le cas échéant, de délivrer aux entreprises un « certificat de conformité ».
« On ne peut pas se permettre d’attendre qu’un organisme se prononce sur l’allégation figurant sur l’étiquette ! »
À Bruxelles, les différents lobbies industriels disent surtout s’inquiéter de la création d’une usine à gaz. Différentes organisations mobilisées en coulisses, dont Cosmetics Europe, FoodDrink Europe pour l’industrie agroalimentaire, Toy Industries of Europe représentant le secteur du jouet, ou encore EUROPEN pour le domaine de l’emballage, ont fait valoir leurs nombreuses préoccupations dans une lettre commune publiée fin février. Du côté de la publicité, la Fédération Mondiale des Annonceurs est aussi sur le pont.
« Si nous produisons dans une usine en Pologne un bien qui doit être commercialisé en France, on ne peut pas se permettre d’attendre qu’un organisme français se prononce sur l’allégation figurant sur l’étiquette ! », pointe le représentant d’une grande entreprise industrielle suivant de près le dossier à Bruxelles.
Ces industries devraient voir leurs messages largement entendus, dans un climat politique où l’UE revendique de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, et de privilégier la compétitivité.
Les probables renoncements à venir
Selon nos informations, il a déjà été acté, par exemple, que le délai de vérification par l’organisme ne pourra pas dépasser une période de 30 jours, renouvelable une fois dans des cas exceptionnels, quand il est nécessaire de se rendre sur le site de production, par exemple.
Plus important encore, pour certaines catégories de produits et d’allégations jugées plus simples, les entreprises pourront échapper à la vérification ex ante, et se contenter d’une autodéclaration en remplissant seulement un « formulaire technique ». Mais quels types de produits ? Ce sera l’enjeu de la prochaine session de négociation, en juin.
« L’objectif est de réduire les charges administratives et financières pesant sur les commerçants générant les allégations », justifie le Conseil de l’UE, la puissante institution représentant les Etats membres, dont la position initiale, fin janvier, au départ de la négociation, était bien plus « pro-business » que celle du Parlement européen.
Sauf qu’entre-temps, le Parti populaire européen (PPE), la première force politique du Parlement qui mène un âpre combat contre les « normes vertes » jugées excessives, a aussi affaibli l’ambition défendue par les eurodéputés.
Au final, les cas éligibles à la « procédure simplifiée » - sans vérification ex ante, donc - pourraient être assez étendus. Une proposition du Conseil voudrait que les allégations concernant des pratiques allant au-delà de ce qui est requis par la législation européenne puissent faire l’objet de cette forme de présomption de conformité. Ce qui semble peu cohérent avec la philosophie initiale du projet de directive, l’objectif de ce type d’allégation étant justement de mettre en avant des pratiques plus vertueuses que la concurrence.
Des lignes rouges préservées
Il semblerait toutefois que les allégations plus « complexes », dont celles ayant trait à l’empreinte climatique, aux performances futures d’un produit, ou comportant des comparaisons avec les biens vendus sur le marché par d’autres entreprises, ne pourraient pas être dispensées du contrôle ex ante.
Une autre victoire en perspective pour les pro-directives, dont les associations de consommateurs : les entreprises auront, a priori, à fournir via un lien ou un QR code un résumé bref et « compréhensible par le consommateur » des études, calculs ou autres preuves servant de fondements à leurs allégations.
« C’est un dossier extrêmement complexe, que l’on doit réévaluer à la lumière des nouvelles priorités européennes de simplification et de compétitivité. En même temps, certains acteurs entendent utiliser ce prétexte pour bloquer ou diluer énormément cette réforme qui doit aller dans le sens de la transparence. Donc, compte tenu de ce contexte compliqué, je dirais que les négociations avancent bien », nous indique l’eurodéputé italien Sandro Gozi (Renew), rapporteur du texte au Parlement européen, selon qui la prochaine réunion de négociation du 10 juin pourrait être la dernière.
À compter de l’adoption finale, probablement pas avant la rentrée de septembre, les 27 États membres auraient ensuite un délai de 18 mois pour transposer le texte dans leur droit national, avec une certaine marge de manœuvre en matière de sanctions en particulier.
Dans sa proposition initiale, la Commission avait certes été très explicite sur les pénalités minimales à prévoir par les États en cas d’infractions. Listées à l’article 17, celles-ci devaient aller, en fonction de la gravité, jusqu’à la privation de l’entreprise d’accès aux marchés publics ou bien à des amendes maximum de 4% du chiffre d'affaires annuel. Sauf que le compromis final s’en tiendra probablement à indiquer les exigences suivantes : les pays « devront s’assurer que les pénalités pouvant être imposées incluent la possibilité soit d’amendes » soit de poursuites judiciaires. Une formulation floue qui semble vouée, en réalité, à laisser quelque peu la main libre aux Etats membres. En l’absence de détails dans un tel texte, la Cour de justice de l’Union européenne vérifiera cependant que les juges des États membres prononcent bien des sanctions suffisamment dissuasives, afin d’assurer une effectivité de l’application de la législation de l’UE. La nouvelle formulation pourrait donc faire traîner des contentieux sur plusieurs années pour déterminer la sanction adéquate.
En tout état de cause, si la copie finale était jugée trop exigeante, les groupes de droite et d’extrême droite, qui forment arithmétiquement une majorité au Parlement européen, réfléchiraient déjà à rejeter la directive lors du vote final en session plénière.
Rédaction : Clément Solal, journaliste
Relecture : Vincent Couronne, docteur en droit européen